Dans ses premières œuvres, Elia Kazan se signala par des préoccupations sociales affirmées et sa direction d’acteurs. Par la suite, il se lança avec passion et nostalgie dans l’évocation du passé récent des Etats-Unis.


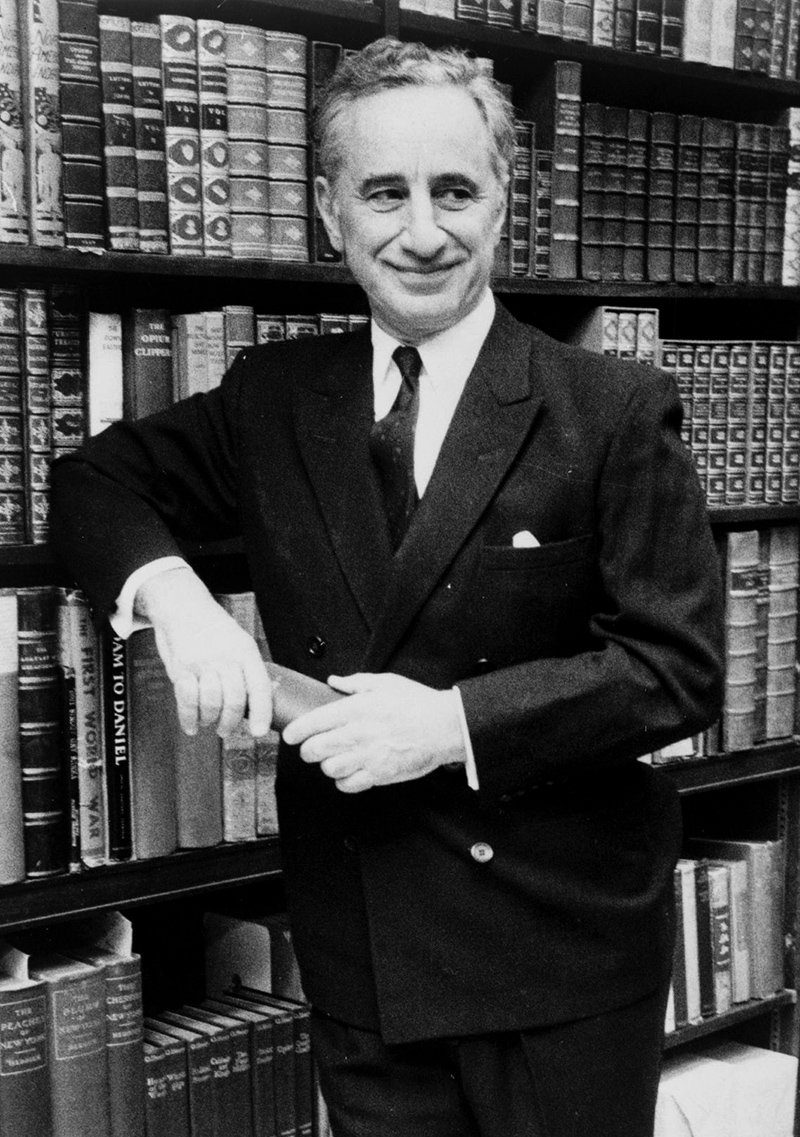
Elia Kazanjoglou est né à Istanbul le 7 septembre 1909. Il a quatre ans quand sa famille émigre aux États-Unis. Devenu Kazan, le petit garçon est élevé à l’américaine. En fait, par les modèles qu’il se choisit (il admire John Ford) et les valeurs auxquelles il est attaché, Elia Kazan est le plus américain des cinéastes. On sent chez lui le respect et l’intérêt pour tout ce qui a contribué à la formation de l’identité américaine, plus même que chez ses confrères nés aux États-Unis. L’enfance perturbée et la condition d’immigré d’Elia Kazan semblent avoir particulièrement développé sa sensibilité aux problèmes de son pays d’adoption.


Dès l’origine, son œuvre porte la marque des tensions entre ses options politiques de gauche et son aspiration à un certain classicisme dans le domaine artistique. Mais la gratitude qu’il éprouve à l’égard de la mobilité de classe de la société américaine – un des aspects les plus positifs du grand rêve américain – entre en conflit avec la déception qu’il ressent en constatant que le phénomène ne joue pas pour tout le monde.

Son premier court métrage, People of the Cumberland (1937), œuvres de collaboration, nous renseignent moins sur ses convictions personnelles qu’ils ne sont un témoignage sur la jeune intelligentsia des années 1930. A cette époque, Elia Kazan joue avec le Group Theatre de New York dans des drames de Clifford Odets et de Sidney Kingsley sous la direction de Lee Strasberg et de Harold Clurman. Metteur en scène de théâtre depuis 1935, c’est comme acteur que Kazan arrive en 1940 à Hollywood où il tourne dans deux films d’Anatole Litvak : City for Conquest (Ville conquise, 1940) et Blues in the Night (1941).

Un maître de la direction d’acteurs
C’est en 1945 que Kazan passe enfin à la réalisation au sein de la 20th Century-Fox. Avec A Tree Grows in Brooklyn (Le Lys de Brooklyn, 1945) sa grande maîtrise de la direction d’acteurs s’affirme d’emblée : Dorothy McGuire, dans le rôle de la jeune Irlandaise Katie Nolan, figure au premier plan dans la galerie des grandes interprétations dirigées par Kazan, tandis que James Dunn, jusque-là insignifiant, remporte l’Oscar du meilleur second rôle avec son interprétation de Johnny Nolan, le père ivrogne et rêveur. Kazan reconnaît qu’à cette époque sa connaissance des moyens offerts par le cinéma était encore limitée, et il attribue la qualité du film à son opérateur, Leon Shamroy.

Boomerang (1947), produit par Louis de Rochemont, marque le début de sa période d’engagement social. Tourné dans un style semi-documentaire, cette tentative de néoréalisme à l’américaine annonce en grande partie le style télévisuel de la décennie suivante. La distribution de Boomerang (comprenant entre autres Lee J. Cobb et Karl Malden) suscita un élogieux commentaire du critique James Agee : « Je n’avais jamais pu dans un même film admirer autant d’interprétations aussi impeccablement réalistes. » Signalons aussi la présence intelligente et discrète de Dana Andrews.

Des thèmes brûlants
Gentleman’s Agreement (Le Mur invisible, 1948) apporte à Kazan le succès et deux Oscars, ceux du meilleur film et de la meilleure mise en scène. Par une ironie du destin, ses chefs-d’œuvre des années suivantes, Wild River (Le Fleuve sauvage, 1960), America, America (1963) et The Last Tycoon (Le Dernier Nabab, 1976) ne lui vaudront guère de succès auprès du public sinon de la critique. Quoique d’une valeur cinématographique relative et bâti sur mesure pour Gregory Peck, Gentleman’s Agreement fut surtout apprécié pour sa dénonciation de l’antisémitisme. De même Pinky (L’Héritage de la chair, 1949), adapté par Dudley Nichols et Philip Dunne, et qui aurait dû être dirigé par John Ford, restera dans les mémoires moins pour ses mérites proprement cinématographiques assez moyens, qu’en tant que tardive prise de position de Hollywood contre les préjugés raciaux.

C’est à peu près à cette période que Kazan commence à subir l’influence du cinéma classique. Ses films témoignent alors d’un plus grand intérêt pour la composition des images et le décor. Panic in the Streets (Panique dans la rue, 1950) film noir tourné dans les bas-fonds de la Nouvelle-Orléans et premier grand film de Kazan, selon le cinéaste lui-même, bénéficie d’excellentes prises de vues en extérieurs et de quelques moments de cinéma pur. Ce penchant pour une composition visuelle flamboyante marquera toute l’œuvre future du cinéaste, à l’exception de la poétique parenthèse que constitue A Streetcar Named Desire (Un Tramway nommé désir, 1951). Kazan dirige avec toute la pudeur voulue la transposition à l’écran de ce drame de Tennessee Williams, une des meilleures œuvres du répertoire théâtral américain. Son expérience de la scène lui permet d’inspirer de brillantes variations à Kim Hunter, à Karl Malden, à Vivien Leigh et à Marlon Brando, le seul des quatre qui ne recevra pas d’Oscar. Vivien Leigh dans le rôle de Blanche Dubois et Marlon Brando dans celui de Stanley sont excellents, et on peut difficilement imaginer meilleure symbiose du cinéma et du théâtre. Pour ses films suivants, Kazan héritera du style baroque, presque hystérique, propre au théâtre de Williams.

En 1952, Kazan fait œuvre très personnelle avec Viva Zapata (1952), en dépit des tendances lourdement didactiques de Steinbeck, auteur du scénario. Marlon Brando s’y montre cependant moins convaincant que dans les autres films qu’il tournera avec Kazan. li n’en est pas de même pour Anthony Quinn qui remporte un Oscar mérité. Jusqu’en 1964 Kazan ne reviendra qu’épisodiquement au théâtre, préférant consacrer tout son temps et toute son énergie à ce qu’il considère comme son vrai métier : le cinéma.



Autobiographies et aliénation Tourné en 1953, Man on a Tightrope est une œuvre de propagande anticommuniste dont Kazan ne se souvient qu’avec embarras. Le film fit, selon les déclarations du cinéaste à Michel Ciment ; « une des recettes les plus basses de l’histoire de Hollywood, Kazan qui incrimine la mauvaise qualité du scénario de Robert Sherwood, proche de sa fin, a expliqué pourquoi il avait tenu à faire ce film : « J’avais vraiment honte d’être effrayé à ce point et tellement enfermé dans le stalinisme… Je crois que beaucoup de gens ici sont encore staliniens, et je me battrai jusqu’à mon dernier souffle contre eux pour qu’ils ne me dominent pas. J’ai vraiment de la haine pour eux. » (Kazan par Kazan). D’autre part, le film eut, sur un autre plan, un effet bénéfique pour le cinéaste. En effet, Zanuck, qui le produisait, en coupa vingt minutes sans consulter Kazan. Celui-ci se jura qu’une telle chose ne se reproduirait plus et que, dorénavant, il exigerait le droit au montage.



Il l’obtint dès 1954 pour On the Waterfront (Sur les quais), puis pour les films suivants pour lesquels il eut les droits complets, étant devenu son propre producteur. Telle fut l’unique conséquence heureuse d’une aventure politico-cinématographique qui lui attira beaucoup d’ennuis et lui valut, dans certains milieux, une réputation de renégat qu’il devra supporter courageusement pendant longtemps. En effet, à la même époque, il est appelé à déposer devant la Commission sénatoriale d’enquête sur les activités anti-américaines : son témoignage contre certains de ses collègues leur attira inévitablement beaucoup de tracas. Pour beaucoup de critiques, l’éclat et la portée de On the Waterfront sont ternis par son plaidoyer en faveur de la délation et des indicateurs. Toute polémique mise à part, l’intelligente interprétation de MarIon Brando dans le rôle de Terry Malloy, l’ancien boxeur qui « aurait pu devenir quelqu’un », reste une des grandes performances de l’histoire du cinéma. Aux côtés de Brando, Karl Malden, Rod Steiger, Lee J. Cobb et Eva-Marie Saint sont tous brillants et justes. Le film récolta une moisson d’Oscars et le personnage de Brando devint un des symboles des années 1950, prototype même du héros aliéné des films de Kazan.

Dans East of Eden (A l’est d’Eden, 1955) James Dean incarnera un autre héros solitaire et insatisfait (son jeu doit d’ailleurs beaucoup à celui de Brando). Kazan dira de Dean : « Le garçon qu’il interprète dans ce film, c’est lui-même, » James Dean, malgré son style un peu trop maniéré, inspiré de l’école de Strasberg, est réellement bouleversant, notamment clans les scènes intimistes avec Julie Harris. Dans ce film, Kazan manifeste un intérêt pour les valeurs familiales qu’on retrouvera par la suite dans ses films les plus personnels : America, America et The Arrangement (L’Arrangement, 1969). East of Eden est sa première réalisation en couleurs et sur grand écran, deux nouveautés que Kazan maîtrise sans peine avec de superbes effets d’éclairage et de très belles prises de vues en extérieurs.



Tiré, comme A Streetcar Named Desire, d’une pièce de Tennessee Williams, Baby Doll (1956) est cependant plus « cinématographique » que ce dernier et Kazan lui-même le juge plus réussi. Le film emprunte au texte de Tennessee Williams son émotion et sa poésie. Kazan y ajoute une forte touche d’érotisme, que les contraintes sévères de la censure d’alors l’obligent à envelopper de nombre d’ambiguïtés et de subtilités, qui ne sont pas un des moindres charmes de cette œuvre pleine de verve et d’un brio cinématographique extraordinaire. Baby Doll(absurdement traduit, lors de sa sortie en France, par La Poupée de chair) exprime aussi la réelle fascination qu’exercent sur le réalisateur le Sud et ses habitants, et qui trouvera son épanouissement dans l’admirable poème du Fleuve sauvage. Enfin l’interprétation des trois protagonistes, Carroll Baker, Karl Malden et Eli Wallach, demeure inoubliable et d’un modernisme sur lequel les ans n’ont pas de prise.



Le film suivant, A Face in the Crowd (Un Homme dans la foule, 1957), demeure un des plus singuliers de Kazan. Il y retrouvait son scénariste de Sur les quais, Budd Schulberg, un des meilleurs écrivains de Hollywood. Comme le souligne Michel Ciment, c’est le seul film de Kazan qui traite directement de politique. Il s’agit d’une dénonciation simultanée de la démagogie et des médias, ainsi que de l’appui que l’une trouve dans les autres. Le héros, Lonesome Rhodes, médiocre produit d’une manipulation qui le dépasse complètement, est cependant riche de suffisamment d’ambiguïtés pour que l’intérêt du film ne se relâche pas, et que jusqu’à la fin le spectateur soit amené à se poser la question : qui est vraiment Lonesome Rhodes? Ni un naïf, ni un intrigant, répond Kazan, seulement un homme dont le pouvoir « venait surtout de ce qu’il voyait des choses que tout le monde ressent, mais que personne n’ose exprimer, et lui, il ose le faire… Et le public pense qu’il a besoin de cet homme ». Aux côtés d’Andy Griffith, interprète exemplaire de ce faux roublard, victime des autres autant que de lui-même, on remarquait Patricia Neal, Walter Matthau, Anthony Franciosa, tous excellents, et dans une brève apparition inoubliable, Lee Remick qui sera, trois ans plus tard, la vedette bouleversante du Fleuve sauvage.



Cinéaste et poète
C’est, de son propre aveu, la période la plus accomplie de Kazan qui débute en 1960 avec Wild River (Le Fleuve sauvage), rencontre du romantisme lyrique à la D.W. Griffith ou à la John Ford et de la poésie naturelle de Robert Flaherty. Une fois encore, l’action se déroule dans le Sud, mais à l’époque d u New Deal et des grands travaux hydrographiques lancés par Roosevelt dans la vallée du Tennessee. Le film se concentre sur le couple Montgomery Clift et Lee Remick, rêveuse et vulnérable, qui donne ici une interprétation d’une sensibilité digne des meilleurs rôles de Vivien Leigh ou de Julie Harris dans les films de Kazan.

Photographié par Ellsworth Fredericks, Wild River se déroule avec lenteur et majesté, sans la frénésie qui animait les œuvres antérieures de Kazan… Maître de son métier, Kazan est alors un véritable artiste, mûr et authentiquement inspiré. Il ne lui manquait plus que d’être poète, avec Wild River, c’est chose faite.

Splendor in the Grass (La Fièvre dans le sang, 1961) est une œuvre bien différente, qui comporte certains éléments autobiographiques empruntés à la jeunesse du cinéaste. On peut penser que le scénario de William Inge contient un peu trop de psychanalyse et n’est pas dépourvu de quelque lourdeur. Mais le travail technique de Kazan est un de ses plus accomplis, d’une perfection qui surprend à chaque plan. L’utilisation de l’espace et des décors révèle cette intelligence du cinéma qui n’est donnée qu’à un très petit nombre de metteurs en scène. La photo, admirable, était signée Boris Kaufman ; après On the Waterfront et Baby Doll, c’était la troisième fois que Kazan faisait appel à l’ancien chef opérateur de Jean Vigo (par ailleurs frère de Dziga Vertov) qui devint pour lui un ami très proche. Abordant ensemble la couleur pour la première fois, ils composèrent des images d’une rare intensité dramatique, au milieu desquelles les visages pathétiques de Natalie Wood et de Warren Beatty se détachaient avec force. Dans un petit rôle, on remarquait Barbara Loden, deuxième épouse de Kazan, qui fut elle-même une réalisatrice de talent (Wanda, 1970) avant de disparaître en 1980.

America, America, le film préféré de Kazan, évoque l’odyssée quasi épique entreprise par son oncle pour se soustraire à la domination turque et émigrer aux Etats Unis, Ce film est l’un des plus puissants témoignages cinématographiques sur un homme : ce cri de vérité sourd de l’âme même du cinéaste. Tiré du premier des romans à succès écrits par Elia Kazan, The Arrangement n’est pas moins personnel. Malgré quelques longueurs et une interprétation pour une fois inégale, c’est un des films autobiographiques les plus authentiques de l’histoire du cinéma, car le metteur en scène y établit un bilan de sa vie en exposant ses limites et ses échecs avec un courage et une honnêteté rares.

A ce film, on peut préférer une œuvre méconnue, The Visitors (Les Visiteurs, 1972) sur un scénario de Chris Kazan, fils du cinéaste. Tournée en 16 mm, « gonflée » en 35 mm pour l’exploitation, cette évocation indirecte de la guerre du Vietnam est tout à fait admirable par son intensité dramatique comme par sa jeunesse d’inspiration aussi bien que d’exécution.

The Last Tycoon conserve une grande part de la poésie mélancolique qui imprègne le roman inachevé de Scott Fitzgerald tout en traitant des rapports de haine et d’amour que Kazan entretient avec Hollywood. L’affable Monroe Stahr, interprété par Robert De Niro, rappelle Terry Malloy : il est fondamentalement seul. Le scénario de Harold Pinter a bien traduit le romantisme crépusculaire du livre, dont Kazan donne une illustration saisissante qui relègue au second plan la peinture de Hollywood. Celle-ci est pourtant savoureuse (l’histoire est inspirée par la vie d’Irving Thalberg, magnat de la MGM) et bien amusants sont les pastiches de films de jadis que Kazan s’est plu à insérer dans son propre film. Il n’est pas jusqu’au générique somptueux qui n’évoque la nostalgie du vieil Hollywood, réunissant autour du jeune couple De Niro-Ingrid Boulting les noms de Mitchum, Nicholson, Tony Curtis, Dana Andrews, Ray Milland, John Carradine, sans oublier Jeanne Moreau, chargée d’incarner les prestiges de la vieille Europe. On comprend qu’un cinéphile comme Claude Beylie ait choisi The Last Tycoon pour clôturer sa « cinémathèque idéale ».

Par la suite, faute de tourner, Elia Kazan s’est considéré plus comme un romancier que comme un metteur en scène, mais pour achever l’histoire de sa famille, il lui restait à réaliser le film qui comblerait le vide entre America, America et L’Arrangement. Compte tenu de la qualité de ces deux œuvres, la trilogie méritait d’être complétée. Quelles que soient les qualités de ses romans, on persistera à penser que si les producteurs avaient penser à Kazan de filmer encore, celui-ci aurait continué à être d’abord ce qu’il a toujours été, un des plus grands cinéastes. Il aurait fallu pour cela qu’il rencontre un « dernier nabab »…


DE STANISLAVSKY À L’ACTORS’ STUDIO
Influencés par les méthodes nouvelles mises au point en Union soviétique par Stanislavski, les acteurs américains adoptèrent un style de jeu capable d’exprimer plus directement l’essence de l’expérience humaine.

MONTGOMERY CLIFT
Au cours de sa brève carrière, Montgomery Clift imposa un nouveau style d’interprétation et composa une figure inoubliable d’Américain tourmenté, correspondant parfaitement aux années de doute et d’anxiété que fut le temps de la guerre froide.

LA CHASSE AUX SORCIÈRES À HOLLYWOOD
En 1947, la capitale du cinéma se transforme en arène politique. Alimentant la psychose anticommuniste, la Commission sénatoriale d’enquête sur les activités antiaméricaines – House Un-American Activities Committee (HUAC) – dénonce les opinions « subversives » de nombreuses personnalités hollywoodiennes. C’est le début d’une nouvelle ère d’inquisition. Rancunes et suspicions seront longues à s’éteindre et le monde du cinéma restera profondément traumatisé par cette crise sans précédent.

JAMES DEAN
Deux grands films avaient suffi à faire de James Dean l’interprète inspiré des angoisses et des inquiétudes de la jeunesse américaine. Guidé par un instinct tragique et capricieux, son talent n’a jamais été égalé. Sa mort brutale l’a fait entrer dans la mythologie du septième art.




- GAS-OIL – Gilles Grangier (1955)
- ARSENIC AND OLD GLACE (Arsenic et vieilles dentelles) – Frank Capra (1944)
- FRITZ LANG ET LE FILM NOIR : UNE TRAVERSÉE DE L’OMBRE
- [la IVe République et ses films] LA QUALITÉ – CLÉMENT ÉPARPILLÉ (8/10)
- ROBIN AND THE 7 HOODS (Les Sept voleurs de Chicago) – Gordon Douglas (1964)
En savoir plus sur mon cinéma à moi
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
Catégories :Les Réalisateurs











